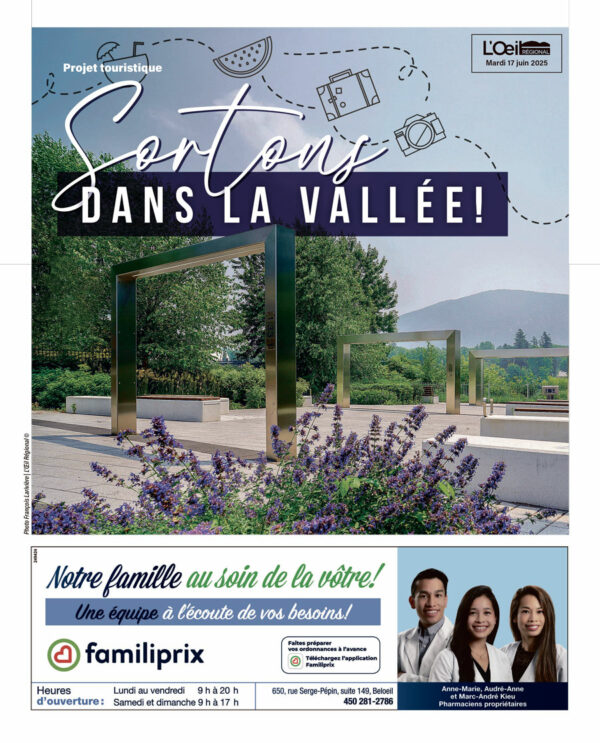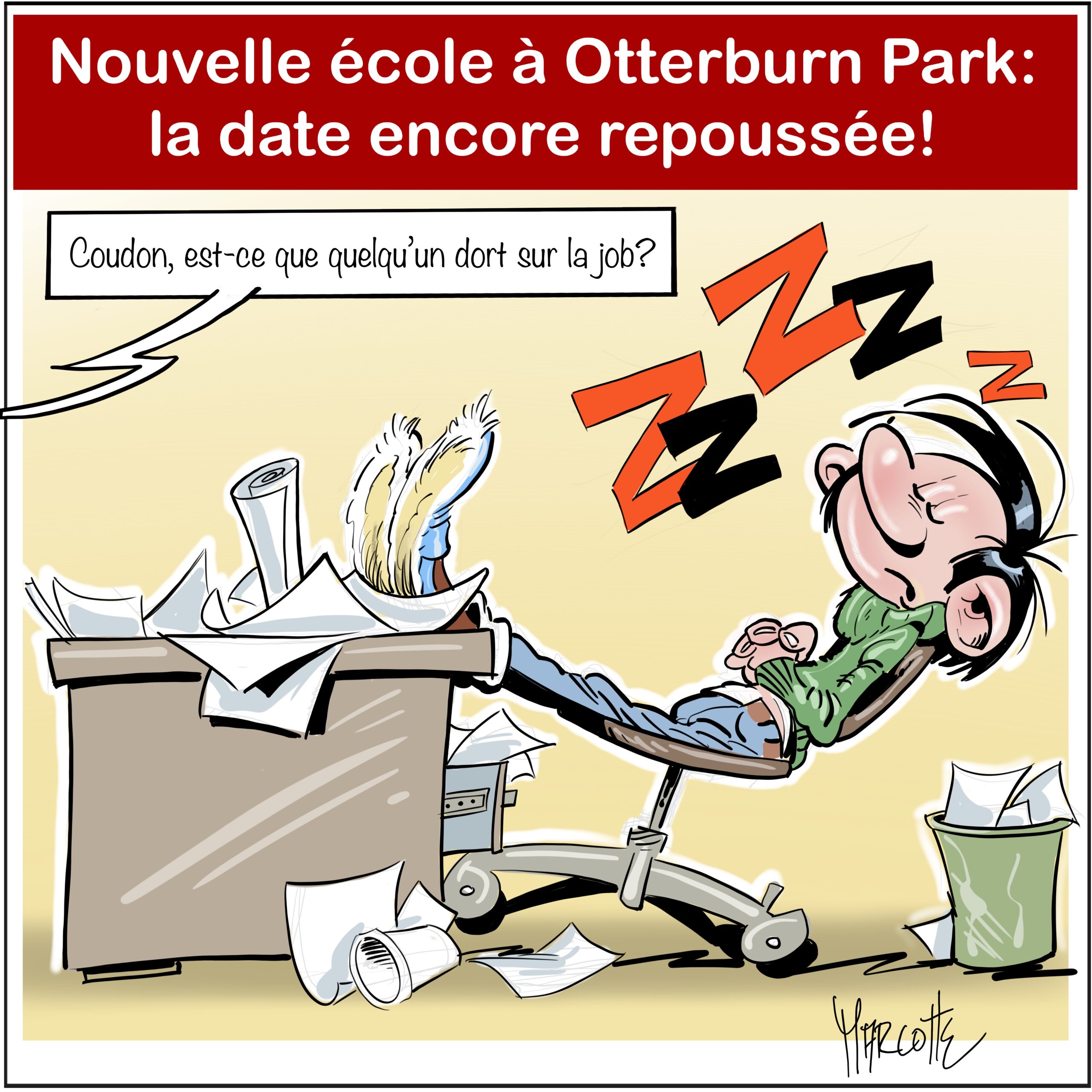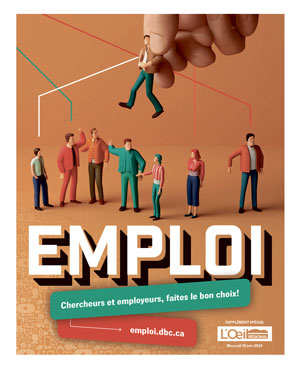L’audit rapporte que La Maison des peuples autochtones fait face à d’importants enjeux de gouvernance, marqués par des retards dans ses obligations administratives, une reddition de comptes jugée insuffisante et des procédures internes non conformes. L’adoption des règlements généraux sans quorum, la tenue d’assemblées sans respect des règles établies, ainsi que des nominations contestées et des décisions ignorées témoignent d’un climat de gestion… instable.
Rappelons aussi que l’audit souligne l’influence que continue d’exercer André Michel, le fondateur, sur le musée, malgré ses prétentions contraires.
En janvier dernier, j’écrivais ceci : « Nul ne peut nier que le musée doit son existence à André Michel, un artiste accompli et un ardent défenseur des arts ainsi que des relations avec les Premières Nations. S’il n’a jamais prétendu avoir des origines autochtones, il a côtoyé ces communautés de près et s’est investi avec passion dans la défense et la mise en valeur de leur culture. Mais aujourd’hui, il semble que sa présence soit plus source de tensions que de stabilité, tant auprès de la Ville qu’au sein même de l’organisme. […] Même s’il ne siège pas au CA, André Michel reste le fondateur du musée, voisin du site, exposant occasionnel entre ses murs et époux de la directrice générale. Sans compter les innombrables heures de bénévolat qu’il y a consacrées. Impossible donc de dissocier son nom de celui de la Maison, même si, officiellement, il n’a pas de rôle décisionnel […] »
L’audit me donne non seulement raison, mais il ajoute aussi qu’il y a « ingérence du fondateur, qui s’occupe du recrutement des administrateurs alors qu’il ne siège pas au conseil d’administration, agit comme “négociateur en chef” sans être mandaté par le CA, et intervient au conseil municipal ».
Je ne veux pas continuer de m’immiscer dans le bras de fer entre la Ville et l’organisme. Ni prendre parti. Et je souhaite tout le mieux du monde au musée. Mais le rapport est quand même accablant. Un ménage doit être fait à l’interne et au sein du conseil d’administration si l’organisme veut continuer de faire affaire avec la Ville. Je vous invite à lire le résumé des conclusions dans le texte de mon collègue Denis Bélanger, qui s’est plongé dans le dossier depuis des mois.
Mais en attendant, je tiens tout de même à soulever la question suivante : comment se fait-il qu’une Ville qui pousse un musée autochtone en dehors de ses murs ne suscite pas plus de vagues à l’échelle provinciale?
Depuis des mois, nous écrivons sur le sujet, alors que dans les médias nationaux, c’est presque le silence. Nous avons reçu une seule communication en provenance de Jacques T. Watso, conseiller élu au Conseil des Abénakis d’Odanak, qui demandait à M. Michel de s’éloigner de la Maison et de laisser les autochtones la gérer. Sinon, rien d’autre. Même le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Ian Lafrenière, ne prend pas part au débat et nous fait parvenir une réponse laconique, soulignant un recul, mais précisant qu’il ne commentera pas davantage.
Où est la résistance? Pourquoi personne ne se lève-t-il pour protester? Ce silence concernant l’importance des institutions culturelles autochtones est troublant.